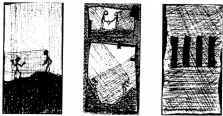Présentation du numéro
La construction de ce numéro a été marquée par deux évènements tragiques : le décès de René Lourau, membre de ce comité de coordination, et celui de Raymond Fonvieille. Celui-ci, co-fondateur de la pédagogie institutionnelle autogestionnaire, auteur de plusieurs ouvrages, participait régulièrement à nos activités éditoriales. Outre son inestimable travail de correcteur, il était le compagnon fidèle toujours prêt à « mettre la main à la pâte » lorsqu’on le sollicitait. Travaillé dès sa thèse de doctorat, le concept d’institutionnalisation demeurait au cœur des préoccupations de René Lourau. La publication de son texte posthume « Formes parsonniennes, formes bakouniniennes d’institutionnalisation » en témoigne. Ce numéro n’est pas un numéro de plus. Nous le produisons à un moment où l’Analyse institutionnelle s’interroge sur son avenir, son propre processus d’institutionnalisation. René Lourau affectionnait les auto-dissolutions. Ce qui nous guette n’est-ce pas plutôt l’évacuation de la dimension politique du concept d’institutionnalisation ? Ceci amènerait à transformer l’Analyse institutionnelle en une simple « théorie des institutions ». Si le concept d’institutionnalisation est central dans l’Analyse institutionnelle, c’est qu’il est opératoire et - avant tout - éminemment politique. Il permet une lecture dialectique de l’institution visant à rendre compte de la transformation de forces sociales en formes sociales. Outre la question : « comment les mouvements deviennent-ils des institutions ? », il fait porter l’attention sur ce que nous instituons par nos actes, ce qui nous met au cœur du concept d’implication. L’institutionnalisation dépasse donc la vieille question individu/société et celle, aussi classique, du rapport entre le social et l’Etat. Nous avons essayé de rendre compte des multiples facettes du concept tout au long de ce numéro. Dans la première partie intitulée Introductions au concept, René Lourau, toujours intéressé par les implications politiques du concept compare les conceptions de deux auteurs qui semblent de prime abord très éloignés - Bakounine et Parsons - tout deux chers à la production intellectuelle de l’auteur. Débora Sada, pour sa part, reprend le concept d’institutionnalisation pour marquer l’existence d’un moment particulier dans le processus qu’elle appelle « moment Agon » et qui marque l’instant de visibilité maximale des contradictions institutionnelles. Une deuxième partie est consacrée à des Eléments de polémique. En effet, le travail du concept, jamais achevé, pousse nos auteurs, Jacques Guigou et Robert Marty à aller plus loin dans leurs questionnements. Jacques Guigou met en doute la validité même du concept en tant qu’outil d’analyse critique de l’Etat contemporain. L’aporie sous roche est constitué de lettres entre Robert Marty et René Lourau autour du concept d’institutionnalisation. Ce texte pointe une difficulté conceptuelle. L’institutionnalisation doit-elle être conçue comme un moment d’un processus ou bien comme le processus lui-même ? Dans la troisième partie, Travail d’institutionnalisation, le concept est mis à l’épreuve en ce qu’il a de plus opératoire. Ainsi certains de nos auteurs analysent le devenir de quelques organisations. Tel est le cas de Lucette Colin et Remi Hess dans leur étude sur l’OFAJ ou bien de Jean Manuel Morvilliers et de sa réflexion sur une structure pour RMIstes. Georges Lapassade et Bénigno Merino travaillent sur des mouvements. Le premier s’intéresse au soufisme tandis que le deuxième analyse un mouvement indigène en Équateur. Dominique Samson, toujours intéressée par la problématique de l’écriture, montre la place tenue par celle-ci dans le travail d’institutionnalisation à travers le cas des « Vies multiples de François » (d’Assise). Christine Delory-Momberger se penche sur le thème de la production de la subjectivité à la lumière des concepts d’implication, institutionnalisation et transduction tandis que Saïd Acef fait l’analyse d’une nouvelle de Kafka à partir d’une conceptualisation de l’Analyse institutionnelle. Régine Angel, Christine Delory-Momberger et Débora Sada
SOMMAIRE
Présentation du numéro ......................................................................................... 5 Introductions au concept .......................................................... 9 R. LOURAU : Formes parsonniennes et formes bakouniniennes d’institutionnalisation ............................................................................................ 11 D. SADA : Le moment Agon ................................................................................. 29 Eléments de polémique ........................................................... 35 J. GUIGOU : Médiation ou combinatoire de particules transductives ? ......... 37 R. MARTY : L’institutionnalisation : y a-t-il aporie sous roche ? ................... 45 Travail d’institutionnalisation ................................................. 55 L. COLIN et R. HESS : Institutionnalisation de l’OFAJ ? L’A.I, un outil d’exploration de l’interculturel ................................................... 57 J-M. MORVILLIERS : Le travail d’institutionnalisation dans le domaine de la santé publique ................................................................. 65 D. SAMSON : Les Vies multiples de François ................................................... 75 C. DELORY-MOMBERGER : L’institutionnalisation ou la " fabrique " du sujet ..................................................................................... 87 G. LAPASSADE : Derviches et fokra .................................................................. 97 B. MERINO : Autodétermination des peuples indigènes en Équateur ........ 104 S. ACEF : La promenade de Joseph K. .............................................................. 119 Et puis aussi ........................................................................... 131 Les auteurs ............................................................................................................ 133 Notes et impressions de lecture ......................................................................... 135 Actualité ................................................................................................................ 143 Sommaires de revues ........................................................................................... 161 Le prochain numéro ............................................................................................. 172 |